Guerre des sexes, éducation, formalisme…
A l’occasion du prochain bicentenaire de la première publication des contes de Grimm (1812), un magazine féminin m’a demandé un assez long entretien.
J’espère utile de le diffuser sur le présent site.
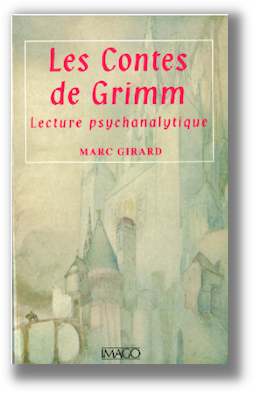
1. Premièrement, je me demandais pourquoi avoir choisi les contes de Grimm comme sujet d’étude de votre livre et quelle est leur force sur les autres contes merveilleux ?
Je ne suis pas un spécialiste de la littérature merveilleuse, et je n’ai pas consacré l’essentiel de ma vie à l’étude des contes dans le monde. Je devrais dire que les contes de Grimm se sont imposés à moi au travers du thème de récurrent de « la fiancée oubliée » – que j’interprète comme l’impératif de la fidélité dans le maelstrom du désir.
2. Vous demandez à juste titre dans votre livre si “le pouvoir des contes tient à l’excitation du voyeurisme ?”, mais vous dites aussi avant que c’est un “lieu de ressourcement” pour les gens de bonne volonté. Cela rejoint la question, parfois même l’affirmation, selon laquelle le conte nous permet d’explorer notre inconscient, pour peut -être résoudre les complexes d’Oedipe, qui selon les psychanalystes sont la racine de notre malheur ? Est-ce que la lecture des contes peut s’apparenter à une démarche psychanalytique ?
Dans mon livre, j’ai posé la question du voyeurisme pour y répondre par la négative : par leur puissance d’abstraction – par leur capacité à créer des types au travers d’histoires qui résonnent pourtant tellement avec notre vécu individuel – les contes de Grimm réalisent les conditions d’une catharsis qui nous permet d’accéder à une vision plus large, plus mûre, mais dûment enracinée dans l’authenticité d’une expérience psychique personnelle profonde, parfois désastreuse. Alors, oui, ces contes opèrent comme une démarche psychanalytique – mais pas dans le sens normatif (et vaguement frauduleux) que Bettelheim a voulu leur imprimer.
Certes il y a du sang, des épreuves, parfois de la torture, mais pas comme en Place de Grève : les méchants qui sont châtiés à la fin ne sont pas des individus précis, mais des figures du Mal, et leur anéantissement a valeur de cicatrisation qui ne fonctionne à l’échelle du lecteur que parce qu’elle vaut pour l’univers entier. Ainsi, il faut avoir déjà réintégré un certain monde de valeurs – et de valeurs collectives – pour que la fonction cicatrisante des contes opère à l’échelle personnelle : le Bien vaut mieux que le mal, l’Amour vaut mieux que la haine, la fidélité vaut mieux que l’impulsivité, la génitalité est meilleure que l’oralité ou l’analité.
3. En ouvrant une fenêtre sur la société actuelle, est-ce que les contes et leur enseignement d’un amour possible, et indestructible, ne sont pas un leurre aujourd’hui, à l’heure où Internet et les réseaux sociaux tels que Facebook, détruisent en un clic des couples et font de l’amour pratiquement un objet de consommation ?
Les contes de Grimm ont la transparence cristalline de l’Idéal : mais ce n’est pas parce que l’Idéal (comme la Vérité) est inaccessible que l’on ne peut pas y tendre – au moins de façon asymptotique. La plupart de ceux qui ont connu des situations extrêmes – le risque d’une mort lamentable, la souffrance de la maladie, la famine – en ont tiré le goût d’expériences élémentaires auparavant jamais ressenties : le temps qui passe tout simplement, le « silence des organes » (R. Leriche), la saveur de l’eau ou d’une miette de pain. Rarement, sans doute, dans l’histoire de l’humanité, les relations sexuées n’auront connu un tel degré d’abjection que de nos jours : mais en parallèle, je ne cesse d’être surpris de la réceptivité des gens à un discours qui, voici encore vingt à trente ans, aurait été sauvagement disqualifié comme franchement débile (je constate en passant que, toutes choses égales par ailleurs, le rythme de réédition de mon bouquin sur Grimm semble s’accélérer avec le temps…). Je suis frappé, par exemple, du nombre de très jeunes filles qui me confient que sous contraception orale – brandie comme conquête insigne par la mouvance féministe –, elles se sentent « castrées » (ce qui est fort plausible, pharmacologiquement) : dans ma génération, un tel aveu aurait suffi à vous rétrograder au rang de gourdasse irrécupérable. Je suis frappé, semblablement, que l’on suscite de moins en moins de ricanements condescendants quand on soutient, comme je le fais, que « l’amour est possible »…
4. Cela m’amène à vous demander votre point de vue sur l’amour dans les contes et comment expliquer cette inéluctabilité que toute relation amoureuse doit subir l’affront d’Eros et Thanatos ?
Le problème des relations entre les hommes et les femmes (mais aussi entre les parents et les enfants), ce n’est pas tellement l’amour : c’est la haine ou, soit dit autrement, la maîtrise de l’ambivalence. Tout le monde – ou presque – sait aimer, car quand nous vibrons au rythme de l’Autre, nous nous sentons « plus » que lorsque nous sommes seuls : mais arrive immanquablement le moment où il se retourne sur l’oreiller pour ronfler, à moins que ce ne soit elle qui prenne toutes les couvertures ou qui parle (quand elle ne grince pas des dents !…) en dormant.
Ce que je veux dire, plus sérieusement, c’est que la haine – le refus de l’Autre, le désir de s’en débarrasser – vient parce qu’on ne peut pas rester durablement à l’unisson avec lui et qu’on en arrive forcément à nos limites mutuelles : l’amour le plus authentique, le plus profond, est aussi l’expérience de la solitude dans son incompressibilité… En sus de cette limitation mutuelle, la surexcitation amoureuse – qu’elle soit physique ou psychique – conduit aussi forcément à une perception de nos limites personnelles (par exemple dans la retombée de l’excitation, ou encore dans la conscientisation de notre vieillissement corporel) et, par conséquent, de notre mort inéluctable : vous avez bien dit « Thanatos »…
5. Selon vous, pourquoi cette terminologie si galvaudée du ” prince charmant ” continue d’être aussi marquée dans les esprits féminins ? Les contes sont-ils sexistes au sens actuel du terme ?
Les contes sont sexués – sinon sexistes – en ce sens qu’ils sont obstinément imperméables à l’illusion moderne que la détermination sexuelle serait essentiellement culturelle : dans la littérature merveilleuse, on ne s’interroge jamais sur « le genre » du vaillant chevalier ou de la belle princesse… C’est aussi ce qui les rend si émouvants : qu’ils retombent immanquablement sur des invariants psychiques profonds par delà des déterminants plus ou moins pittoresques de chaque récit en particulier.
S’il s’agit maintenant de répondre à votre question (je devrais dire : à votre provocation) en affrontant le risque – considérable – de parler en homme de « la féminité », il me semble que l’enjeu du désir n’est pas le même de l’un à l’autre sexe. L’essence de la virilité, c’est la maîtrise dans (et non pas de) l’excitation : l’exigence contraceptive – qui, selon toutes les grandes éthiques érotiques, repose sur les épaules de l’homme – en découle. A l’inverse – et je connais peu de femmes qui me contredisent sur ce point une fois tombé le masque du féministement correct – la jouissance féminine passe par l’abandon : c’est « se jeter par la fenêtre » me disait ma très vieille analyste qui, à la différence de beaucoup de ses collègues, savait manifestement de quoi elle parlait.
Seulement, pour se jeter par la fenêtre si l’on n’est pas cinglée, il faut avoir une confiance éperdue en la main de l’homme qui vous tiendra dans le vide : c’est justement la maîtrise contraceptive de ce dernier qui rend cette confiance possible. Je l’ai encore écrit récemment : il y a quelque chose d’intrinsèquement violent – de carrément bestial – dans le désir de l’homme pour la femme et la seule façon de négocier cette violence à deux sans qu’elle opère comme principe de dégradation, c’est d’instaurer entre les deux partenaires un signe visible attestant que tout cela reste dans le domaine du jeu et que, même dans l’affolement mutuellement consenti – voire encouragé –, la maîtrise reste à portée : tel est l’enjeu de la contraception – tant il est vrai que, de tous les animaux, l’homme est le seul à distinguer accouplement et reproduction, et à rechercher consciemment le premier pour le seul plaisir.
A l’inverse, comment voulez-vous qu’une femme s’abandonne si elle a déjà été obligée de falsifier son corps (par la chimie pharmacologique ou la technologie médicale) pour affronter son partenaire : comment voulez-vous même qu’elle respecte un amant qui la contraint à une telle violence sur elle faute de maîtriser tant soit peu la sienne ? Faut-il donc s’étonner que, sur arrière-fond de mépris de plus en plus radical à l’endroit de l’homme, la frigidité (fût-elle masquée par quelques spasmes… de surface) soit clairement la pathologie sexuelle la plus répandue dans notre modernité – à laquelle répond l’éjaculation précoce, apparemment de plus en plus fréquente également chez des hommes qui n’ont jamais appris à vraiment sentir leur corps ? Je pense donc que le mythe du prince charmant renvoie au fantasme d’un homme surpuissant (prince), mais absolument maître de sa force et de son désir (charmant).
6. Comment et pourquoi la virilité masculine est remise en cause dans les contes de Grimm ? N’y-a-t-il pas une certaine résonance dans la société actuelle ?
Je ne suis pas certain d’avoir dit que la virilité masculine était « remise en cause » dans les contes de Grimm, mais je pense que ceux-ci représentent avec beaucoup de finesse ce mélange de force et de fragilité qui fait la virilité (tant il est vrai que la fragilité n’est pas incompatible avec la virilité…). Il me semble que cette fragilité masculine a au moins deux sources. D’une part, la peur de l’homme – dont j’ai parlé dans un récent article – à l’égard de la femme et des puissances supposées de la féminité. Mais d’autre part, également, l’expérience de « la castration » que tout homme (à la différence de la femme) a dans son corps de façon innée – ce décrochage formidable entre l’énormité d’excitation qui peut l’envahir et la retombée brutale, dont la traduction physiologique la plus visible est la détumescence qui suit l’éjaculation, mais dont la résonance psychique est infiniment plus profonde. Je suis persuadé que l’adage antique – « post amorem (…) » : « après l’amour tout animal est triste » – vaut pour l’homme exclusivement : à cause de son rapport, même fantasmatique, à la maternité, la femme ne vit pas la séquence de l’accouplement à l’unisson avec son partenaire et, de toute façon, sa constitution anatomique la préserve de l’anxiété quant à la résurgence de sa puissance. Ce n’est probablement pas un hasard si la plupart des métaphysiciens sont des hommes : avec son espoir de gros ventre – et tout ce qui vient après – le rapport de la femme à la mort ne peut être superposable à celui de l’homme, et c’est aussi ce qui la rend si dangereusement vulnérable à la violence machiste. La femme, du moins quand elle est jeune, ne voit pas venir la mort…
7. Est-ce que le conte de Blancheneige peut servir de miroir (excusez le jeu de mots involontaire) à notre société actuelle prônant le jeunisme ? D’ailleurs l’année prochaine deux films sur Blancheneige vont voir le jour, trouvez-vous qu’il s’agisse d’une coïncidence ?
S’il est un conte tristement actuel – dont on voit tous les jours des représentations saisissantes, qui dépassent la fiction – c’est bien celui-ci. Comme nous n’y étions pas, il est difficile de savoir comment c’était avant (quoiqu’on ait quelques indications historiques des frères Grimm), mais tout porte à croire que le refus de vieillir et la jalousie à l’égard des plus jeunes sont portés à leur acmé dans une société comme la nôtre qui refuse obstinément le fatum de la mort (et donc l’inéluctabilité du vieillissement) et l’exigence du transgénérationnel (et donc l’impératif du don).
La différence entre l’amour d’un Autre de l’autre sexe et l’amour parental, c’est que dans le second, on donne à fonds perdu – sans jamais rien attendre en retour et, plus encore, sans esprit de revanche ou de compensation si l’on n’a soi-même pas eu ce que tout enfant devrait recevoir de ses parents : on ne se répare pas en faisant des enfants… Mais cet idéal altruiste de parentalité fonctionne mal dans une société où une proportion effarante des adultes en âge d’être parents sont déjà estropiés par une enfance désastreuse et qui, de toute façon, ne cultive que les valeurs de la consommation.
7 bis. Est-ce que chaque mère est naturellement ” marâtre ” ?
On ne peut pas aborder cette question sans considérer le rôle du père (la triangulation), qui opère – ou devrait opérer – comme séparateur, en arrachant l’enfant à sa mère et sa femme à l’enfant. Eventuellement sous la forme moderne à dominante séductrice qui consiste à encourager « libéralement » les jeunes filles à une sexualité de plus en plus précoce qu’elles n’ont évidemment pas les moyens d’affronter (ce qui est une méthode pas moins efficace que la pomme empoisonnée pour compromettre durablement l’épanouissement d’une jeune beauté), une mère sera d’autant plus marâtre qu’elle n’aura pas elle-même été engagée dans une relation avec un partenaire suffisamment profonde pour lui faire perdre le goût de la symbiose avec ses enfants : il suffit de regarder autour de soi pour voir l’illustration pluriquotidienne de ce que j’essaie de vous expliquer.
8. Dans votre livre, vous expliquez à un moment que ” la polarité idéale assumée (des contes) sans complexes ” est ce qui porte ces contes à l’essence même de l’art “. J’ai observé depuis les années 2000 une résurgence importante des contes dans les œuvres d’artistes contemporains, ceux-ci les détournant pour la plupart mais de façon à toucher au plus près le spectateur ou d’établir des parallèles avec le monde actuel. Les années 2000 et la période actuelle étant très chaotiques, c’est comme si les artistes souhaitaient retourner aux sources primitives, tribales de l’humain. Est-ce pour cette raison qu’ils mettent en scène, détournent ou réinventent le conte ? Ce dernier serait-il finalement un outil de contestation ?
C’est encore une question extrêmement explosive que vous abordez là – car vous avez probablement décidé de me brouiller avec tout ce qui se fait d’intellectuellement, de politiquement et de sexologiquement correct !…
La bourgeoisie ne s’est jamais remise du traumatisme de l’impressionnisme – non pas tant d’être passée à côté d’un mouvement artistique qui a mis quelque temps à se faire reconnaître (c’était déjà arrivé dans l’histoire de l’art), mais de la honte consistant à avoir privilégié, par contraste, les œuvres et les artistes les plus ignobles (amusez-vous à comparer même les plus faibles des tableaux impressionnistes avec les œuvres qui étaient célébrées dans les Salons officiels…). Il en a découlé, durant plus d’un siècle, une tendance à privilégier de plus en plus hystériquement et l’innovation, et (ce qui en est la marque de fabrique la plus facile) la forme même dans ses exubérances les plus folles – au détriment du fond et, plus précisément, des valeurs. C’est, à mon humble avis, l’essentiel du problème actuel autour de Céline : les gens qui jouent avec le vocabulaire – « les rénovateurs de la langue », comme on dit – ont toujours beaucoup excité les intellectuels français mais, à choisir, entre deux écrivains qui se sont l’un comme l’autre acharnés sur les mots, personne ne pourra m’empêcher de préférer Flaubert (ou Hugo), précisément sur le critère des valeurs (je ne parle pas des valeurs que chacun a cultivées dans sa vie, mais de celles qu’il a charriées dans ses œuvres). Après tout, quand on a le sens des formes et le talent technique, on peut très bien sculpter la merde1 : du point de vue de la réception, personne ne m’empêchera de préférer le marbre blanc…
Un symptôme éloquent de cette dérive formaliste qui ne comble aucun besoin profond de l’homme, c’est que les œuvres qui, statistiquement, attirent le plus les gens aujourd’hui, ce sont notamment les formes les plus traditionnelles d’art religieux (pas nécessairement catholique) – c’est-à-dire d’expression artistique explicitement et consciemment structurée autour d’une adhésion assumée à des valeurs cardinales : même si le spectateur d’aujourd’hui ne les partage plus, il en perçoit l’effet. C’est un petit peu la même chose avec la résurgence très récente d’intérêt pour les contes anciens : les gens sentent bien qu’au travers de toutes ces histoires apparemment simples ou folkloriques, il y a un contenu qui tient aux expériences humaines fondamentales du désir, de l’amour et de la mort – tandis que la pauvreté contemporaine de leur vie relationnelle en exacerbe la nostalgie.
9. Est-ce que les contes sont alors un discours moralisateur (via notamment l’influence de Disney qui résiste dans l’inconscient collectif) ou une fuite face à la réalité ?
J’ai dûment expliqué, dans mon livre, à quel point je tenais les adaptations de Disney pour des falsifications (d’une certaine beauté formelle plutôt respectable), effectivement guidées par un esprit de récupération moralisatrice. Maintenant, tout dépend de ce qu’on appelle « morale » : celle de Disney, comme celle de Perrault, me paraît étroite, culturellement très déterminée et éminemment contestable à ce titre. Avec la « morale » des contes de Grimm, on touche à des invariants qui sont infiniment mieux partagés.
Il est extrêmement intéressant, à mon sens, que ce soit la psychanalyse qui nous permette le mieux de repérer et de caractériser ces invariants – et c’est ce à quoi je me suis attaché dans mon livre. Ce constat – de la puissance herméneutique de la psychanalyse dès qu’on en arrive aux valeurs fondamentales – renvoie évidemment à une question ancienne et éminemment controversée, à savoir la « moralité » que distille la psychanalyse elle-même : je reste par exemple frappé que dans ma clientèle de psychothérapeute qui va de catholiques intégristes à des indifférents en passant par des Témoins de Jéhovah ou des musulmans pratiquants, les invariants axiologiques assumés qui structurent ma pratique (et, notamment, mes interprétations des relations entre les sexes) semblent susciter fort peu de résistances… Dans « Le monde d’hier » (S. Zweig) où il vivait, Freud – qui avait bien d’autres chats à fouetter – a pu se permettre de botter en touche et affecter d’ignorer la question : mais dans l’indécence axiologique absolue où se complaît la modernité, il est d’autant moins possible de continuer sur cette voie que les délires formalistes franchement pervers (sous prétexte de « retour » à Freud !) où a conduit l’usurpation lacanienne incitent, en réaction, à reconnaître avec soulagement la robustesse morale et épistémologique du corpus freudien.
10. Pensez-vous que la violence dans les contes de Grimm puisse être comprise par les enfants ?
Noble scrupule que le vôtre, quand il est patent que, dans leur immense majorité (via la télé ou les jeux vidéo), les enfants contemporains sont chaque jour confrontés à des images de sadisme et de violence gratuite que, franchement, je serais moi-même incapable de supporter (je n’ai jamais eu la télé…). J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer la « violence » éminemment abstraite des contes qui, dans un environnement à peu près « normal », devrait au contraire renvoyer les enfants à un idéal de pulsions maîtrisées (dont celle de vengeance). Mais dans le monde de sous-hommes que s’appliquent à nous concocter toutes les instances du libéralisme – l’école, la publicité, l’industrie du divertissement, la médecine… –, il est difficile d’anticiper sur l’impact des images fortes véhiculées par la littérature merveilleuse. Heureusement, comme les Kinder- und Hausmärchen ne s’inscrivent pas naturellement dans la culture des loubards (des « sauvageons ») contemporains, il y a peu de risque que l’on retrouve demain une victime enfermés dans un tonneau dont les clous seraient tournés à l’intérieur, ou forcée de danser jusqu’à ce que mort s’ensuive dans des pantoufles métalliques chauffées à blanc. Cependant, certains jeunes ont d’autres sources d’inspiration étrangement convergentes : cramer au chalumeau les pieds d’un vieux pour obtenir le code de sa carte bleue…
Pour que la « violence » des contes de Grimm – littéralement effrayante, en effet – ait une fonction psychiquement intégrative, encore faudrait-il premièrement que les enfants d’aujourd’hui vivent dans des conditions de sécurité, ce qui est loin d’être le cas, évidemment (et c’est pourquoi je n’aime pas du tout le mouvement contemporain de « renouveau » des contes, qui en rajoute encore sur la violence et la crudité : ce n’est pas le moment…) Et deuxièmement, qu’à l’inverse du sinistre principe mis à la mode par les Meirieu et autres pervers de l’éducation, les conditions sociétales soient remplies pour que ce soit l’enfant qui observe les adultes – et non l’inverse : au ton, à la physionomie de celui qui lui raconte l’histoire, l’enfant comprendrait que ce qui se joue transcende complètement la crudité du détail et vise à la cicatrisation d’un monde mis en danger par ceux des hommes et des femmes qui ne veulent pas comprendre qu’il y a plus important que leur petit nombril – ou leur petite libido.
11. Enfin, pensez-vous que la force des contes s’opère grâce à la dualité du réalisme et du merveilleux ?
Là encore, tout dépend de ce que l’on entend par « réalisme ». Hormis mon investissement dans la littérature merveilleuse – qui justifie la présente interview – mon activité de critique a, bizarrement, concerné la littérature dite « réaliste ». Or, même avec l’expérience de cet extrême que l’on appelle le « naturalisme » (Zola), j’ai rarement perçu plus de réalisme psychologique et humain que dans les contes de fées : après tout, quelqu’un d’aussi politiquement correct que Perrault ne craint quand même pas d’aborder de front la question de l’inceste (Peau d’Âne).
Ainsi, sur un corpus d’histoires sélectionnées à la veillée, au cours des siècles, pour leur puissance d’évocation émotionnelle (l’amour, la mort, le désir, l’envie, l’interdit…), la mise en forme littéraire, sous prétexte de « merveilleux », a permis de préserver l’indicible essentiel du contenu humain inhérent à ces histoires. Il est frappant, par exemple, qu’à chaque fois que les Grimm essaient de « moraliser » une histoire dont les déterminants leur apparaissent trop crus, ils retombent – à leur corps défendant ? – sur une version non moins crue. La jeune fille sans mains en est un bon exemple : partant d’une tradition narrative très ancienne où un père incestueux, pour se venger de sa fille qui refuse ses avances, lui fait couper les mains et les seins, les Grimm concoctent une version où le père se contente de lui couper les mains – censément sur ordre du Malin –, mais où son incompétence paternelle n’en apparaît que plus clairement. De même, leur version de Peau d’Âne, pour maîtrisée qu’elle soit, appréhende la dégradation de la victime avec une profondeur qu’on aimerait retrouver dans les expertises pénales ordonnées à l’occasion d’affaires similaires…
- Dans un article que je ne connaissais pas quand j’ai répondu à cette interview, Georges Orwell, qui assume hautement son “respect” pour Céline “écrivain”, le décrit “comme une voix sortant de la fosse septique” (“Culture et démocratie”, Ecrits politiques (1928-1949), Marseille, Agone, 2009: p. 209).